La guerre de Pierre Renouvin (presque) au jour-le-jour-histoire
Le grand historien des relations internationales est surtout connu pour ses réflexions sur les causes de la Grande Guerre mais en tant que contemporain de la Seconde Guerre mondiale, il suivit avec toutes ses ressources propres les événements de 1938 à 1945. Notes sur la guerre (1938-1945) est donc un manuscrit établi à partir de ces notes par Robert Frank, autre très grand nom de l’histoire des relations internationales, avec Maryvonne Le Puloch. On y voit combien la génération influe sur les esprits les mieux formés et aspirant le plus à « une neutralité axiologique ».
RELATIONS INTERNATIONALES - GÉOPOLITIQUEHISTOIREHISTORIOGRAPHIEDOCUMENTS ET STATISTIQUES
Franck Jacquet
10/28/20245 min lire
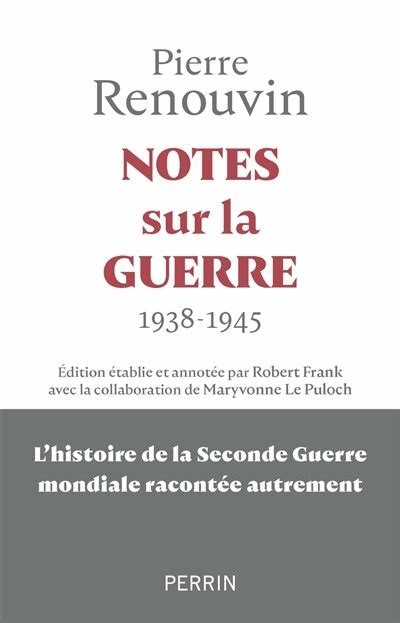
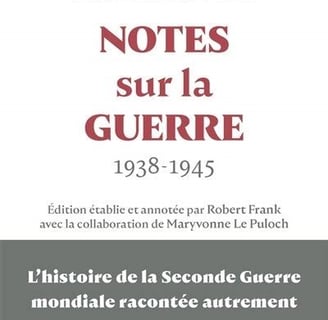
Le grand historien des relations internationales est surtout connu pour ses réflexions sur les causes de la Grande Guerre mais en tant que contemporain de la Seconde Guerre mondiale, il suivit avec toutes ses ressources propres les événements de 1938 à 1945. Notes sur la guerre (1938-1945) est donc un manuscrit établi à partir de ces notes par Robert Frank, autre très grand nom de l’histoire des relations internationales, avec Maryvonne Le Puloch. On y voit combien la génération influe sur les esprits les mieux formés et aspirant le plus à « une neutralité axiologique ».
Une scansion quasi-quotidienne de l’occupation
Robert Frank et Maryvonne Le Puloch nous aident beaucoup dans ce livre tombant à point nommé pour l’année de commémoration du débarquement, ou plutôt des débarquements : l’introduction nous rappelle la filiation Renouvin – Duroselle – Frank comme une trinité pour ceux qui cherchent à étudier l’histoire des relations internationales françaises. C’est cette école avec Pierre Renouvin qui commence à étudier les « forces profondes », à aller au-delà des événements pour mettre en avant que l’histoire - bataille s’explique souvent aussi par l’idéologie, la société, l’économie ou encore la démographie… Ensuite, pour revenir « aux débarquements », on voit à quel point Le Débarquement est attendu par notre auteur dès 1943 dans la foulée de l’opération Torch, mais aussi le rôle des autres opérations pour prendre pied sur le continent avec succès surtout par la péninsule italienne par les Alliés.
S’il ne s’agit pas d’un journal intime, les éléments liés au for intérieur sont peu nombreux, cela s’explique parce que Pierre Renouvin veut rester le plus neutre possible, un spectateur des événements pour essayer de les analyser le plus cliniquement possible, dans la filiation de la révolution des sciences sociales à la fin du XIXe siècle. On est donc très loin de la manière d’être à l’histoire d’un Marc Bloch.
Mais on trouve dans ce manuscrit une extrême richesse de détails et un fourmillement de connaissances attestant de la grande culture amassée par le professeur de Sorbonne, bénéficiaire d’un réseau de hauts fonctionnaires amis depuis plus de deux décennies, comme d’un français « lambda » écoutant tantôt les radios de collaboration ou celles de Londres. Ainsi, des événements paraissant secondaires prennent toute leur place non pas par notre recul mais aussi et d’abord par les remarques sur tel acteur, élément de contexte ou telle tactique clé qui constitue un point de bascule que l’auteur « anticipe » dans des notes qu’il nomme « impressions ». Le savant bénéficie de pleinement de son savoir pour anticiper à quelques encâblures… De même, il sait connecter les événements et les faits relevant de l’un ou de l’autre des fronts : sans passer par des raisonnements qui parfois sont aujourd’hui spéciaux, il observe que la guerre est bien mondialisée, qu’elle l’est d’ailleurs plus qu’entre 1914 et 1918 et que les fronts font réseau.
Le lest des grandes forces de l’opinion
Mais certains décalages sont étonnants et montrent que nul n’est prophète exempte de faiblesses en prospectives, et nul n’est pleinement neutre.
En effet, Pierre Renouvin est typique de sa génération et de ceux passés par les armes durant la Grande Guerre, et il croit longtemps dans Pétain lorsqu’il sous-estime ou se méfie au moins autant que les dirigeants américains du Général De Gaulle. Il est « sauvé » par sa méthode : il isole les faits qu’il relate fidèlement ; puis il évoque ses impressions et ses réflexions. Si les premières se révèlent assez bonnes, les secondes tombent souvent à côté du réel, notamment du fait de ses influences, du « bain social » dont il est issu. Il ne s’agit pas ici de condamner cet historien-clé qui n’aurait pas su prédire l’avenir, ce n’est pas l’objet de l’histoire. Mais son indulgence envers le Maréchal Pétain est sans aucun doute liée à son passé individuel, au fait qu’il est catholique conservateur, tendance anti-américaine et très anti-communiste. Au contraire de bien des césures majeures se dessinant durant le conflit, il saisit dès 1943 la montée des « russes », les soviétiques donc, qu’il estime toujours capables de conclure une paix séparée (nous avons tant oublié, aujourd’hui, le pacte Molotov – Ribbentrop !) et déplore que les Balkans ou la Pologne leur soit abandonnés.
A l’inverse, puisqu’il adhère au moins à la figure de Pétain, bien qu’il déteste Laval et se méfie de la « Révolution nationale », rejetant toute « propagande » qu’il moque car tournant de semaine en semaine comme une girouette, il ne s’en détourne que très tardivement et croît un temps à la possibilité d’une France neutre et devant se replier sur ses principaux atouts, la mer et l’Afrique du Nord. C’est donc avec Torch et avec le non-choix d’un camp lors de cette occasion qu’il se détache du dirigeant de Vichy. Avec du recul, on s’aperçoit donc qu’il suit largement sur ce point l’opinion qui semble assez majoritaire en France au même moment. Et ce alors même qu’il constate que les fronts commencent à s’inverser.
Mais là où il manque de sources, il ne peut combler. Il ne voit pas l’ampleur de la machine industrielle américaine qui fournit la Grande Alliance et sous-estime souvent les Anglo-Saxons jusqu’à montrer son étonnement lorsque de grandes poches sont conquises très rapidement (Sicile, Belgique…). De même, comme bien des Français, il est un ancien combattant amputé d’un bras, ce qui l’empêche aussi dans son quotidien et, s’il en avait eu les idées, d’être résistant. Mais son frère meurt dans un camp après avoir été capturé pour une telle activité, et son fils Michel est sauvé par son universitaire de père qui fait jouer de ses réseaux en été 1944 pour éviter sa mort alors qu’il est emprisonné à Orléans. Tout autant, on le voit pris dans le mouvement de la libération de Paris : l’ampleur des notes, des tournures moins neutres, quelques remarques sur son environnement personnel voire quelque élan d’humeur ne laissent pas de toute… Nul ne peut rester de marbre quand l’histoire sonne à son pas de porte.
Cet ouvrage pour passionnés de diplomatique et de batailles permet de faire la jonction avec ces fameuses « forces profondes » que l’auteur lie avec les faits qu’il observe ou qu’on lui relate. Il nous rappelle aussi que les plus grands penseurs de notre temps formulent des analyses sans aucun doute renseignées, plus ou moins objectives mais jamais réellement neutres et qui peuvent toujours être chamboulées par des acteurs clés : Pierre Renouvin s’est détaché du vieux Maréchal, mais, tout homme de la IIIe République qu’il fut, il paria pour l’histoire française (et non l’internationale), plus sur le retour des radicaux que sur l’empreinte de Charles de Gaulle qui allait marquer le second XXe siècle français.
REFERENCE : Pierre Renouvin (édition établie par Robert Frank et Maryvonne Le Puloch), Notes sur la guerre (1938-1945), Paris, Perrin, octobre 2024 - ISBN : 978-2-262-10088-9 (24 euros)
ISD - Paris
Institut Saint-Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com OU isdaccueilcontact@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2026 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
